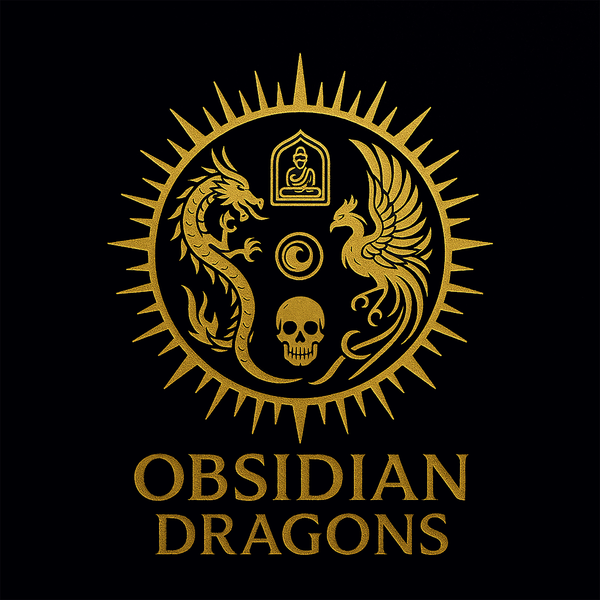Les 18 Arhats (Luohan) – Disciples du Bouddha et Gardiens du Dharma
Share
Préambule
Cet article explore en profondeur la tradition des Dix-huit Arhats — appelés Luohan en Chine, Rakan au Japon et Arhat dans le bouddhisme indien.
Ces disciples éveillés de Gautama Bouddha, figures vénérées du bouddhisme Mahāyāna et Theravāda, incarnent la sagesse, la compassion et la protection de la foi.
De leurs origines en Inde à leur intégration dans l’art et la culture bouddhiste de la Chine, du Tibet, du Japon et de la Corée, les Luohan sont représentés dans les temples, peintures, sculptures et récits légendaires.
À travers cet article, découvrez leur histoire, leur rôle spirituel, leurs attributs symboliques, ainsi que l’héritage artistique et culturel qu’ils laissent aux pratiquants et passionnés de bouddhisme et de spiritualité asiatique.
Plan de lecture – Découverte des Dix-huit Arhats et de leur signification.Introduction – Qui sont les Arhats ?
1) La place des Arhats dans le bouddhisme
2) Les Dix-huit Luohan – Protecteurs de la foi bouddhiste
3) Portraits et légendes des Dix-huit Arhats
|
Introduction: Qu’est-ce qu’un Arhat ?
Dans la tradition bouddhiste, un Arhat (chinois simplifié/traditionnel 罗汉 / 羅漢 Luohan, coréen 아라한, japonais 羅漢 Rakan, tibétain dgra bcom pa, littéralement « celui qui a vaincu les ennemis des afflictions ») désigne un pratiquant ayant atteint un état d’éveil si avancé que la réincarnation n’est plus nécessaire. Le nirvana se trouve alors à portée immédiate. Selon les enseignements, tous les véritables disciples du Bouddha sont destinés à devenir des Arhats. Dans l’imaginaire populaire, ces figures spirituelles sont souvent associées à des pouvoirs surnaturels et à une sagesse exceptionnelle.
Parmi eux, les Dix-huit Arhats – appelés Luohan en Chine – occupent une place centrale, en particulier dans le bouddhisme chinois et d’Asie de l’Est. Disciples directs de Gautama Bouddha, ils ont suivi le Noble Chemin Octuple, franchi les quatre étapes de l’illumination et atteint l’état d’Arhat, libérés à jamais des désirs et illusions du monde. Leur mission ne s’arrête pas là : ils demeurent dans ce monde pour protéger la foi bouddhiste et attendre l’avènement de Maitreya, le Bouddha du futur, promis à venir guider l’humanité dans les âges à venir.
1) La place des Arhats dans le bouddhisme
La Vision Theravāda de l’Arhat : l’Ultime Éveil
Dans le bouddhisme Theravāda – appelé « Petit Véhicule » – un Arhat est celui qui a pleinement compris la véritable nature de l’existence et qui a réalisé le nirvana. Cet état représente le but ultime de la pratique bouddhique : l’extinction des afflictions mentales, la fin du cycle des renaissances dans le monde de la souffrance (saṃsāra), et l’accès à la condition où « il ne reste rien à apprendre ».
Bien avant l’essor du bouddhisme, dans l’Inde ancienne, le terme Arhat désignait déjà une personne sainte, associée aux pouvoirs miraculeux et à une vie d’ascèse. Le Bouddhisme a conservé ce titre, mais en en modifiant la signification : les miracles ne sont plus au centre de l’identité ou de la mission d’un Arhat, l’essentiel résidant dans la sagesse et la libération.
Selon cette tradition, après l’Éveil, les cinq agrégats – forme physique, sensations, perceptions, formations mentales et conscience – continuent de fonctionner tant que dure la vie corporelle. Cet état est appelé nibbāna avec résidu. Mais à la mort de l’Arhat, lorsque le corps se désintègre, les cinq agrégats cessent définitivement, marquant la disparition totale de toute existence conditionnée : c’est nibbāna sans résidu, ou parinirvāṇa.
Le Bouddha lui-même est considéré, dans le Theravāda, comme un Arhat, tout comme ses disciples les plus accomplis. Libérés de toute souillure – avarice, haine, ignorance, illusions – ils perçoivent la réalité telle qu’elle est, ici et maintenant. Le terme sanskrit arhat, participe présent de arh- (« mériter »), signifie littéralement « méritant » ou « vainqueur de l’ennemi », l’ennemi étant ici la cupidité, la colère et l’ignorance.
Être Arhat constitue la quatrième et ultime étape du chemin du śrāvaka (disciple). La différence majeure avec un Bouddha réside dans la voie empruntée : l’Arhat atteint l’Éveil grâce à l’enseignement d’un maître, tandis que le Bouddha parvient seul à cette réalisation.

La Perspective Mahāyāna : De l’Arhat au Bodhisattva
Dans le bouddhisme Mahāyāna – ou « Grand Véhicule » – le chemin du śrāvaka, qui consiste à rechercher avant tout la libération personnelle du saṃsāra, est souvent perçu comme une voie limitée, voire égoïste. Certains textes vont jusqu’à considérer cette aspiration exclusive au nirvāṇa individuel comme extérieure à l’idéal bouddhiste authentique.
Plutôt que d’aspirer à devenir Arhat, le pratiquant Mahāyāna est encouragé à suivre la voie du Bodhisattva, celle qui vise non seulement l’Éveil personnel mais aussi la délivrance de tous les êtres. Un Arhat, selon cet enseignement, doit tôt ou tard embrasser cet idéal. S’il ne le fait pas au cours de la vie où il a atteint l’état d'Arhat, il demeure dans un profond samādhi de vacuité jusqu’à ce qu’il soit éveillé pour poursuivre la voie du Bodhisattva. Le Sūtra du Lotus affirme que tout véritable Arhat acceptera finalement le chemin Mahāyāna.
Le Mahāyāna estime que le śrāvaka agit souvent par crainte du saṃsāra, ce qui limite sa capacité à viser la bouddhéité complète. Il lui manquerait les qualités fondamentales du Bodhisattva : courage, sagesse et compassion. De plus, sans la compréhension profonde de la prajñāpāramitā (perfection de sagesse) et la maîtrise des moyens habiles (upāya), la progression vers l’Éveil complet reste incomplète.
Le Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra relate ainsi l’histoire de soixante Bodhisattvas novices qui, malgré leurs efforts, atteignirent l’état d’Arhat plutôt que celui de Bouddha, preuve que la voie peut bifurquer si la motivation ultime n’est pas claire.
Si le Mahāyāna considère l’état d'Arhat comme un accomplissement honorable mais secondaire face à l’illumination parfaite, il n’en retire pas pour autant tout respect : les royaumes des Bouddhas sont dépeints comme abritant à la fois Arhats et Bodhisattvas, chacun occupant sa place dans l’ordre cosmique.
Dans le bouddhisme chinois, tibétain et d’autres traditions d’Asie de l’Est, cette vision a toujours été acceptée. Certaines lignées vénèrent ainsi des groupes spécifiques d’Arhats, tels que les Seize Arhats, les Dix-huit Arhats ou encore les Cinq cents Arhats.
Dans cet article, nous porterons notre attention sur les Dix-huit Arhats, disciples éveillés de Sakyamuni.

2) Les Dix-huit Arhats : Protecteurs de la foi bouddhiste
Origines de la liste des 18 Arhats
Dans le bouddhisme Mahāyāna, les Dix-huit Arhats – ou Luohan en chinois – sont présentés comme les disciples originels du Bouddha Gautama. Ayant suivi le Noble Sentier Octuple et franchi les quatre étapes de l’illumination, ils ont atteint l’état de nirvāṇa, libérés des désirs et des illusions de ce monde. Leur mission est double : protéger la foi bouddhiste et demeurer sur Terre en attendant l’avènement de Maitreya, le Bouddha du futur, dont l’arrivée est prophétisée plusieurs millénaires après le parinirvāṇa de Gautama Bouddha. En Chine, ces figures spirituelles sont également un thème privilégié de l’art bouddhiste.
À l’origine, la tradition mentionnait seulement dix Arhats. Les premiers sūtras indiens précisent même que seuls quatre d’entre eux – Pindola, Kundadhana, Panthaka et Nakula – avaient reçu l’ordre du Bouddha d’attendre la venue de Maitreya. Les premières représentations chinoises des Arhats, datées du IVᵉ siècle, mettaient surtout à l’honneur Pindola, popularisé dans l’art par l’ouvrage Méthode pour inviter Pindola (賓度羅, Qǐng Bīndùluó Fǎ).
Par la suite, le groupe s’élargit à seize Arhats, intégrant patriarches et adeptes éminents. Leur enseignement parvint en Chine, où ils furent appelés Luohan (transcription de « Arhat »). En 654, le Nandimitrāvadāna (法住記, Fǎzhùjì) – récit de la durée de la Loi prononcé par le grand Arhat Nadimitra – fut traduit en chinois par Xuanzang, fixant ainsi leurs noms. Pour une raison inconnue, Kundadhana fut retiré de cette liste.
Entre la fin de la dynastie Tang et le début de la période des Cinq Dynasties et Dix Royaumes, deux nouveaux Luohan furent ajoutés, portant leur nombre à dix-huit. Ce format s’imposa dans la tradition bouddhiste chinoise moderne. Un culte dédié aux Luohan en tant que gardiens de la foi se développa surtout à la fin du IXᵉ siècle, à la suite des persécutions religieuses sous l’empereur Tang Wuzong.
Iconographie et art bouddhiste chinois
L’empereur Qianlong (XVIIIᵉ siècle) fut un admirateur fervent des Luohan. En 1757, lors d’une visite pour contempler leurs peintures, il examina chaque image avec attention et composa un éloge funèbre pour chacune. Ces textes furent conservés au monastère, puis en 1764, Qianlong ordonna la reproduction des œuvres et leur gravure sur tablettes de pierre pour les préserver. Elles furent installées comme des facettes sur un stūpa de marbre, exposées au public. Bien que le temple ait été détruit durant la rébellion des Taiping, des frottis à l’encre des stèles furent sauvegardés, en Chine et à l’étranger.
Dans la tradition chinoise, les dix-huit Luohan sont généralement présentés dans l’ordre où ils seraient apparus à Guan Xiu – éminent moine bouddhiste, peintre, poète et calligraphe. Né en 832 à Lanxi (province du Zhejiang) et décédé en 912 à Chengdu (province du Sichuan), il est surtout célèbre pour son œuvre magistrale représentant les seize Arhats.

3) Portraits et légendes des Dix-huit Arhats
1) Pindola Bharadvaja – L’Arhat qui Chevauche un Cerf
(Chinois : Qílù Luóhàn 骑鹿罗汉 ou Zuòlù Luóhàn 坐鹿罗汉 ; Japonais : Bindora Baradaja 賓度羅跋囉惰闍 ou Binzuru 賓頭盧 ; Tibétain : ར་དྷྭ་སྙོམས་ལེན་, Bharadodza Sönyom Le)

Selon les premiers sūtras bouddhistes indiens, Pindola Bharadvaja faisait partie des quatre Arhats auxquels le Bouddha confia la mission de demeurer dans le monde afin de propager le Dharma. Chacun d’eux était associé à l’une des quatre directions cardinales, et Pindola excellait dans la maîtrise des pouvoirs occultes et psychiques.
Cependant, il reçut un jour une réprimande du Bouddha pour avoir utilisé ses pouvoirs dans le but d’impressionner les gens simples. Cette sagesse acquise par l’humilité allait marquer le reste de sa vie spirituelle.
Dans une existence antérieure, il avait été un homme cruel et irrespectueux envers ses parents, ce qui lui valut de longues souffrances au purgatoire, se nourrissant de briques et de pierres. Dans cette vie-ci, il naquit au sein d’une famille d’aumôniers royaux, mais ne trouva aucun sens à cette existence mondaine. Constatant le respect accordé aux disciples du Bouddha, il décida de rejoindre la communauté monastique.
Au début, il était enclin à la gourmandise et parcourait les rues avec un grand bol d’aumônes, mais suivant les conseils directs du Bouddha, il apprit à se contenter de ce qu’il recevait et atteignit rapidement l’état d’Arhat. Plein de gratitude, il consacra le reste de sa vie au service des autres, vivant souvent retiré dans les bois, en harmonie avec les animaux qui l’affectionnaient. Par sa méditation constante, il développa des capacités surnaturelles : voler dans les airs comme un oiseau et faire résonner sa voix avec la puissance d’un lion ou d’un tigre.
Son histoire raconte qu’il retourna un jour au palais de Jūshè-mí, où il avait servi comme haut fonctionnaire, chevauchant un cerf. Là, il convainquit le roi d’abdiquer et de devenir disciple du Bouddha. Depuis, il est traditionnellement représenté assis sur un cerf, tenant dans sa main droite un rouleau d’écritures et dans sa main gauche un bol d’aumône. Il vit, selon la tradition, dans une grotte de montagne sur le continent oriental (Pūrvavideha) avec mille autres Arhats, prêt à exaucer les vœux, conférer la sagesse et protéger du malheur.
« Assis dignement sur un cerf, comme plongé dans une profonde réflexion. Dans un calme parfait, content d’être au-dessus des poursuites du monde. »
Pourquoi invoque t'on l'arhat Pindola Bharadvaja?
Pindola Bharadvaja est invoqué principalement pour ses pouvoirs de guérison et de protection spirituelle. Dans de nombreuses traditions d’Asie, il est vénéré comme un gardien du Dharma demeurant sur Terre jusqu’à l’avènement de Maitreya, et les fidèles sollicitent son aide pour préserver la pureté des enseignements bouddhistes.
Au Japon, sous le nom de Binzuru, on frotte la partie de sa statue correspondant à la zone malade afin d’obtenir un soulagement physique ou mental.
On lui attribue aussi la capacité d’insuffler force intérieure, longévité et clarté d’esprit, sa voix symbolique chassant l’ignorance comme un rugissement de lion.
Méditer sur lui ou l’invoquer revient à rechercher une guérison profonde, à la fois du corps et de l’esprit, et à recevoir sa protection bienveillante contre les obstacles spirituels.
Attributs et symboles de Pindola Bharadvaja
-
Cerf : symbole de sérénité, de longévité et de sagesse.
-
Rouleau d’écritures : représentation du Dharma et de la transmission de l’enseignement bouddhique.
-
Bol d’aumônes : signe d’humilité, de détachement et de vie monastique.
-
Voix de lion : métaphore de la puissance spirituelle capable de dissiper l’ignorance.
-
Lieu de résidence : une grotte de montagne sur Pūrvavideha, accompagné de 1 000 arhats, soulignant son rôle de guide et protecteur.
2) Kanāka-vatsa – L’Arhat Joyeux
(Chinois : 迦諾迦伐蹉 Jiānuòjiāfácuō ; surnom iconographique : 喜庆罗汉 Xǐqìng Luóhàn ; Tibétain : གསེར་གྱི་བེའུ ; translit. courantes : Kanakavatsa / Kanaka-vatsa)

Jiāfá-cuō 伽伐蹉, connu dans la tradition sous le nom de Kanāka-vatsa, était l’un des disciples les plus renommés du Bouddha. On disait de lui qu’il connaissait à fond tous les systèmes de pensée de son époque — qu’ils soient justes ou erronés — et qu’il savait les expliquer avec une clarté rare. Cette compétence était précieuse à une époque où la quête de vérité se heurtait à une multitude d’écoles philosophiques, chacune présentant des arguments parfois séduisants mais trompeurs, ou au contraire, apparemment faibles mais porteurs de vérités cachées. Grâce à sa vaste érudition, Jiāfá-cuō discernait aisément le vrai du faux, le sage du sot. Cette lucidité lui procurait la paix intérieure, et cette capacité à distinguer la sagesse de la folie nourrissait en lui une joie profonde.
Selon la tradition des Seize et Dix-huit Arhats, Kanāka-vatsa se distingue avant tout par son éloquence limpide, capable d’éclairer les doctrines authentiques et de dissiper les vues erronées. Les textes liturgiques tibétains le situent au Cachemire, sur la « colline au safran », entouré d’un cortège de cinq cents arhats — image de son autorité spirituelle et de son rôle de gardien du Dharma.
La légende raconte qu’il reçut des nāgas un lasso de joyaux, symbole de son pouvoir d’enseignement : capturer l’esprit grâce à la parole juste pour le guider vers la compréhension. Il est également parfois représenté tenant un mala, signe d’une mémoire infaillible et d’une maîtrise parfaite de l’esprit, qualités qui faisaient de lui un transmetteur sûr, bienveillant et respecté du Dharma.
« D’un rire clair comme la source de montagne,
il délie les nœuds de l’ignorance.
Ses mots sont filets de lumière,
capturant les cœurs pour les offrir au Dharma. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Kanāka-vatsa ?
On invoque Kanāka-vatsa pour recevoir la clarté d’esprit, une mémoire fiable, la confiance juste et la parole bienveillante — des qualités essentielles pour étudier, assimiler et transmettre fidèlement le Dharma. Les traditions rapportent que ses bénédictions assurent aux pratiquants de rester proches de leurs maîtres spirituels et de jouir du respect de tous, préservant ainsi l’harmonie et le lien sacré au sein de la communauté bouddhiste.
Attributs et symboles de Kanāka-vatsa
-
Lasso de joyaux (don des nāgas) : symbole de son pouvoir d’enseignement, capable de « capturer » l’esprit pour le guider vers la vérité.
-
Mala : signe de sa mémoire prodigieuse et de sa maîtrise de l’esprit, atouts dans l’étude et la récitation du Dharma.
-
Lieu de résidence : le Cachemire, sur la « Colline au Safran », entouré de 500 arhats, reflétant son rôle de chef spirituel et de gardien du Dharma.
-
Qualités : éloquence limpide, sagesse pragmatique et assurance dans la transmission des enseignements.
3) Kanāka-bharadvaja – L’Arhat levant un bol d’aumône
(Chinois : 举钵罗汉 Jǔbō Luóhàn ou 迦諾迦跋厘惰闍 Jiānuòjiābálíduòduō ; Tibétain : གསེར་བ་བྲ་དྷྭ་ཛ ; translit. courantes : Kanaka-bharadvaja / Kanāka-bharadvāja)

Kanāka-bharadvaja, appelé en chinois Jǔbō Luóhàn, était reconnu pour son mode de vie ascétique singulier. Comme tous les moines errants de l’époque du Bouddha, il vivait uniquement d’aumônes. Mais contrairement aux autres disciples, il ne sollicitait jamais directement les dons. Sa méthode consistait à lever son bol de mendicité au-dessus de sa tête, tourné vers le ciel, tout en entonnant des chants mélodieux.
Ces chants avaient un double effet : certains, agacés par cette insistance sonore, lui donnaient de la nourriture pour qu’il cesse ; d’autres, touchés par la sincérité et la vibration de sa voix, reconnaissaient en lui un homme saint et offraient volontiers leur soutien. Cette pratique devint sa marque distinctive et lui valut son surnom d’« Arhat levant un bol d’aumône ».
Les textes liturgiques tibétains le situent dans la région de Vijayapuri ou dans certaines versions en Gandhara, vivant au sommet d’une colline, dans un ermitage ouvert au vent et au ciel. Sa posture, le bol levé, n’était pas qu’un geste physique : elle symbolisait l’accueil des bénédictions célestes, la réceptivité à la compassion universelle et le renoncement total à l’ego.
Sa physionomie est également singulière : on le décrit comme un homme particulièrement velu, détail parfois conservé dans l’iconographie, surtout en Chine. Il porte souvent un large sourire, reflet de sa joie intérieure, et un bol d’aumône rond ou cylindrique qu’il lève haut, parfois accompagné d’un bâton de pèlerin.
« Le bol levé vers le ciel n’attend rien,
et pourtant tout lui est donné.
Dans le souffle d’un chant,
le cœur se remplit comme une coupe ouverte. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Kanāka-bharadvaja ?
Pour cultiver l’esprit de renoncement, la gratitude, la joie simple et la confiance en la générosité de la vie. On l’invoque aussi pour apprendre à “laisser venir” — recevoir sans s’attacher, partager sans compter — et pour harmoniser la parole par le chant qui apaise et élève.
Attributs et symboles de Kanāka-bharadvaja
-
Bol d’aumônes levé : réceptivité aux bénédictions, confiance absolue dans le Dharma.
-
Chant : pouvoir vibratoire qui purifie l’esprit et édifie autrui.
-
Pilosité/chevelure abondantes : signe d’ascèse, d’authenticité non policée.
-
Ermitage sur une colline : détachement, vision élargie, disponibilité au ciel.
4) Suvinda / Shubhinda (Nandimitra) – L’Arhat tenant une pagode
(Chinois : 托塔罗汉 Tuōtǎ Luóhàn ou 苏频陀 Sūpín-tuó ; variantes indiennes : Suvinda, Shubhinda, parfois Subhadra ou Nandimitra)

Dans la tradition bouddhique, Nandimitra est reconnu comme le dernier disciple à avoir été accueilli par le Bouddha au cours de cette vie. Alors que le Maître approchait de son parinirvāṇa, Nandimitra demanda avec une insistance humble mais inébranlable à recevoir un ultime enseignement. Sa détermination fut telle qu’il obtint enfin l’autorisation d’entrer en présence du Bouddha et d’être ordonné, scellant à jamais son engagement en gardant le nom du Bouddha gravé dans son cœur.
En mémoire de cette rencontre ultime, l’iconographie le représente tenant une pagode à étages, symbole tangible de la présence vivante du Bouddha et de la garde vigilante des reliques sacrées. Dans certaines traditions, il est figuré en train de claquer des doigts, geste signifiant la rapidité de son éveil. D’autres représentations le montrent près d’un bol d’aumônes, d’un brûle-parfum ou tenant un rouleau d’écriture, signes de dévotion, d’étude et de culte. On rapporte également qu’il présidait à un cortège de 800 arhats « mineurs », image de son rôle de guide et de protecteur du Dharma.
En Asie de l’Est, sa pagode est interprétée comme un signe que « le Bouddha est toujours avec lui ». Selon certaines légendes populaires, elle renfermerait des śarīra (reliques sacrées), renforçant son surnom de « Luohan à la pagode élevée ».
« Pagode aux sept étages, pouvoir du Bouddha déployé :
puissance sans colère, présence qui éclaire. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Tuōtǎ (Nandimitra) ?
Les fidèles se tournent vers Nandimitra pour affermir leur foi, conserver une mémoire fidèle des enseignements du Bouddha et obtenir une compréhension claire et instantanée, à l’image de son éveil fulgurant. Il est aussi prié pour protéger les reliques et les lieux sacrés, et pour préserver l’intégrité de la pratique au sein de la communauté, garantissant l’unité autour du Dharma.
Attributs et symboles de Tuōtǎ Luóhàn
-
Pagode (塔) : symbole de la présence vivante du Bouddha, de la garde des reliques et de la protection du Dharma.
-
Écriture / bol d’aumônes / brûle-parfum : signes de l’étude, de l’offrande et du culte des reliques.
-
Claquement de doigts : représentation de l’éveil instantané et de la détermination sans hésitation.
-
Cortège de “800 arhats” : évocation de son autorité spirituelle et de son rôle de guide.
5) Vakula / Nakula – L’Arhat méditant
(Chinois : 静坐罗汉 Jìngzuò Luóhàn ou 距罗 Nuòjù-luó ; variantes : Vakula, Nakula)

Dans la tradition des Arhats, Nakula (ou Vakula) est dépeint comme un ancien guerrier d’une force physique exceptionnelle et à la stature imposante. Mais après avoir connu la vanité de la violence, il abandonna les armes pour embrasser la voie de la paix. Assis en méditation profonde, il conservait une présence si intense que sa puissance semblait toujours rayonner, même dans l’immobilité absolue. Cette transformation de la force martiale en sérénité intérieure lui valut le titre d’« Arhat méditant ».
De nombreuses légendes l’identifient au Nakula du Mahābhārata : fils de Pāndu et de la reine Madri, frère jumeau de Sahadeva, image terrestre des dieux cavaliers Aśvins. Admiré pour sa beauté et sa maîtrise du combat, il choisit pourtant de se détourner des batailles, convaincu que donner la mort était un acte stérile, incapable de restituer la vie. Il se consacra dès lors à l’exploration méditative, cherchant à percer le mystère de l’existence et à apaiser les tourments de l’esprit.
« Le puissant guerrier devient roc du silence ;
dans la méditation, il est paix et présence immuable. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Vakula / Nakula ?
On l’invoque pour fortifier la stabilité intérieure, affermir la discipline personnelle et cultiver une paix profonde qui demeure intacte face aux tumultes du monde. Il incarne la capacité à métamorphoser la force brute en énergie spirituelle, inspirant à persévérer sur la voie malgré les épreuves.
Attributs et symboles de l’Arhat méditant
-
Posture assise de méditation : fusion de la force physique et du calme intérieur, image de la transformation spirituelle.
-
Aura de puissance : présence imposante, même dans le silence, rappelant vigilance et détermination.
-
Chapelet (mala) ou petit disciple : transmission de la paix et continuité du Dharma à travers l’enseignement.
Vakula / Nakula est l’exemple vivant que la véritable victoire ne se remporte pas sur un champ de bataille, mais dans la conquête silencieuse de soi.
6) Bhadra – L’Arhat qui traversa les rivières
(Chinois : 过江罗汉 Guòjiāng Luóhàn ou 跋陀罗 Bátuóluó – « arbre de la vertu »)

Né sous l’arbre de la vertu (bátuóluó), Bhadra reçut dès la naissance un nom qui annonçait sa destinée spirituelle. Serviteur du Bouddha lorsqu’il était encore prince, il devint l’un de ses disciples les plus dévoués. Animé par le vœu de dissiper la souffrance et de répandre la voie de la libération, il partit prêcher le Dharma jusqu’en Orient.
Les récits rapportent qu’il traversait les rivières avec la légèreté d’une libellule, avançant sans effort tout en méditant et récitant ses sutras. Cette aptitude devint son symbole : « l’Arhat qui traverse les rivières ». Dans certaines traditions, il est également nommé Bodhidruma, mais c’est toujours l’image du passage fluide d’une rive à l’autre qui domine, métaphore du chemin spirituel vers l’éveil.
« Portant les sutras, naviguer vers l’Est pour répandre le monde.
Gravir les montagnes et franchir les ruisseaux,
pour la délivrance de l’humanité. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Bhadra ?
Bhadra est sollicité pour accomplir la traversée vers l’autre rive, celle de la sagesse et de la libération. Sa légende inspire la détermination sereine : franchir les obstacles sans résistance inutile, et diffuser la vérité du Dharma avec fluidité et constance. Il est aussi invoqué comme protecteur des voyageurs spirituels et gardien du chemin juste.
Attributs et symboles
-
Traversée des rivières avec légèreté : symbole de la grâce et de la maîtrise face aux épreuves.
-
Sutras portés en main : représentation de la mission d’enseigner et de transmettre le Dharma.
-
Nom lié à la vertu : rappel de la pratique juste, pure et protectrice.
-
Rôle de guide : il aurait conduit de nombreux disciples jusqu’à l’éveil, incarnant le maître qui ouvre la voie.
7) Karika (Kalika / Kala) – L’Arhat conduisant un éléphant
(Chinois : 迦力迦 Jiālǐ-jiā ou 骑象罗汉 Qíxiàng Luóhàn — « l’Arhat sur l’éléphant »)

Dès sa naissance, Jiālǐ-jiā se distingua par un trait insolite : ses sourcils, d’une longueur inhabituelle, tombaient jusque devant ses yeux. Chaque fois qu’il les coupait, ils repoussaient aussitôt, comme pour signifier un lien mystique avec le cycle éternel de la vie. Ce signe singulier devint l’un de ses attributs iconographiques.
Mais la véritable renommée de Jiālǐ-jiā vient de son don unique pour comprendre et guider les éléphants. Dans les plaines et forêts de son pays, il apprivoisa des animaux réputés indomptables. Là où d’autres usaient de chaînes ou de cris, lui employait la patience, le regard et la parole douce. Les éléphants, sensibles à cette énergie bienveillante, le suivaient et exécutaient ses ordres avec une obéissance presque joyeuse. Cette amitié hors du commun entre l’homme et l’animal inspira son surnom poétique : « L’Arhat conduisant un éléphant ».
Dans certaines légendes, on raconte qu’un éléphant furieux, échappé d’un cortège royal, semait la panique dans un village. Les habitants, terrifiés, s’étaient barricadés, mais Jiālǐ-jiā s’avança seul, récitant les sutras à voix haute. L’animal, au lieu de charger, s’inclina devant lui, apaisé par la vibration des mantras.
« Conduisant un éléphant avec un port digne,
chantant haut les sutras.
Le cœur ouvert pour l’humanité,
les yeux parcourant les quatre coins de l’univers. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Karika ?
Karika incarne la force maîtrisée par la compassion, un symbole de puissance au service du Dharma. On l’invoque pour :
-
Apaiser les colères intérieures et dompter l’ego comme on dompte un éléphant.
-
Développer la patience et la maîtrise émotionnelle.
-
Trouver l’équilibre entre autorité et douceur dans la conduite des êtres.
-
Cultiver une sagesse qui ne cède pas à la violence, même face à la force brute.
Dans le bouddhisme, l’éléphant est un symbole majeur : il représente à la fois la puissance de l’esprit indiscipliné et, lorsqu’il est dompté, la stabilité de la conscience éveillée. Karika est donc l’archétype de celui qui a transformé l’instinct sauvage en énergie spirituelle pure, guidant non par la contrainte mais par l’exemple.
Attributs et symboles de Karika
-
Éléphant : incarnation de la force maîtrisée, de la sagesse patiente et de la mémoire du Dharma.
-
Sourcils amples et longs : marque distinctive, signe de sagesse et d’exception.
-
Chant des sutras : vibration qui apaise, harmonise et relie tous les êtres.
-
Posture digne sur l’éléphant : image de la suprématie de l’esprit sur la force physique.
Karika nous enseigne que la vraie puissance n’est pas celle qui écrase, mais celle qui conduit avec bienveillance. Comme l’éléphant dompté qui devient protecteur des chemins sacrés, l’esprit discipliné devient gardien du Dharma et compagnon de route pour tous les êtres.
8) Vājraputra – L’Arhat jouant avec un lion
(Chinois : 笑狮罗汉 Xiàoshī Luóhàn ou 舞狮罗汉 Wǔshī Luóhàn – « L’Arhat au lion rieur » ou « dansant »)

Vājraputra, dont le nom signifie « fils du vajra » — le foudre-diamant, symbole de l’énergie indestructible et de l’éveil — fut autrefois un chasseur renommé, redouté dans tout le royaume pour sa maîtrise de la traque et sa force implacable. Il connaissait les forêts comme sa propre main et savait pister le moindre souffle de vie. Parmi ses proies les plus recherchées figuraient les lions, souverains des plaines et gardiens des vallées.
Pourtant, malgré ses succès, une inquiétude silencieuse l’habitait. Chaque vie qu’il ôtait déposait en lui une ombre plus lourde. La pensée ne cessait de le hanter : « Et si un jour j’étais traqué comme je poursuis ces êtres ? Et si l’on désirait ma chair ou mes os ? » Ces réflexions devinrent insupportables jusqu’au jour où il rencontra le Bouddha. Les paroles du Maître, évoquant l’interdépendance de toutes les vies et la souffrance universelle, furent pour lui comme un coup de vajra qui brisa ses chaînes intérieures. Il renonça aux armes et se fit moine, déterminé à ne plus nuire.
C’est alors qu’un événement merveilleux se produisit. Alors qu’il méditait dans la forêt, deux jeunes lions — orphelins depuis peu — s’approchèrent sans crainte. Sentant qu’ils n’avaient rien à redouter de cet homme autrefois chasseur, ils vinrent se blottir contre lui. Les jours passèrent, et l’un des lionceaux, plus espiègle, prit l’habitude de jouer avec son nouvel ami : tirer doucement sur son vêtement, bondir autour de lui pendant ses méditations, ou poser sa tête sur ses genoux. La forêt entière semblait bénir cette amitié improbable.
Ainsi naquit l’image intemporelle de l’Arhat jouant avec un lion : non pas le dompteur imposant sa force, mais l’ami véritable qui transforme la peur en confiance et la violence en joie partagée.
« Ludique et sans inhibitions,
le lionceau bondit de joie.
Alternant aisément tension et détente,
se réjouissant avec tous les êtres vivants. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Vājraputra ?
On le prie pour adoucir le cœur, pour dissoudre les tendances violentes et pour éveiller la compassion même là où régnaient autrefois colère et domination. Il inspire à transformer la puissance brute en énergie protectrice et bienveillante. Le lion, dans l’iconographie bouddhique, symbolise la voix du Dharma, majestueuse et invincible — mais ici, il apparaît joueur et pacifié, rappelant que la véritable force n’a pas besoin de rugir pour se faire entendre.
Attributs et symboles de Vājraputra
-
Lionceau joueur : incarne la puissance apprivoisée par l’amour, la transmutation de l’instinct destructeur en lien protecteur.
-
Posture détendue mais vigilante : union de la sérénité et de l’attention éveillée.
-
Expression joyeuse : appel à pratiquer la voie sans austérité excessive, dans une joie simple et profonde.
-
Lien indestructible avec la nature : rappel que l’éveil s’inscrit dans l’harmonie avec tous les êtres vivants.
Vājraputra est le visage lumineux de la rédemption : preuve que même ceux qui ont versé le sang peuvent devenir source de protection et de joie, lorsque la sagesse et la compassion remplacent la peur et la violence.
9) Gobaka – L’Arhat dévoilant son cœur
(Chinois : 戍博迦 Shùbó-jiā ou 开心罗汉 Kāixīn Luóhàn — « L’Arhat au cœur ouvert » ou « joyeux »)
 Avant de suivre la voie du Bouddha, Shùbó-jiā était prince héritier d’un petit royaume. Promis à la couronne, il se sentait pourtant étranger à la soif de pouvoir et au faste de la cour. Ce que son âme désirait, ce n’était pas le trône, mais la sérénité de la forêt, l’enseignement du Dharma et la réalisation de l’illumination.
Avant de suivre la voie du Bouddha, Shùbó-jiā était prince héritier d’un petit royaume. Promis à la couronne, il se sentait pourtant étranger à la soif de pouvoir et au faste de la cour. Ce que son âme désirait, ce n’était pas le trône, mais la sérénité de la forêt, l’enseignement du Dharma et la réalisation de l’illumination.Mais son choix risquait d’embraser le royaume. Son plus jeune frère, avide de régner, craignait que Shùbó-jiā ne cède pas la couronne et préparait une rébellion armée pour s’en emparer. Comprenant que la violence allait couler le sang, l’aîné décida de mettre fin au conflit avant qu’il ne commence.
Il convoqua son frère et lui parla avec calme : il ne désirait pas gouverner, car son cœur n’était pas tourné vers la gloire, mais vers la vérité éternelle. Le cadet, sceptique, l’accusa de ruse : « Aucun homme ne renonce volontairement à régner. »
Alors, Shùbó-jiā se leva, écarta les pans de sa robe, et révéla ce qu’aucun mortel n’avait jamais vu : au centre de sa poitrine, à la place d’un simple cœur, rayonnait le visage paisible d’un Bouddha. C’était la preuve irréfutable que son cœur ne contenait rien d’autre que la nature de Bouddha — pure, lumineuse, sans ambition mondaine. Le frère, bouleversé, renonça à la guerre et accepta la couronne.
« Ouvrez le cœur et il y a Bouddha,
chacun révélant sa véritable force.
Nul besoin de rivaliser,
car le pouvoir de Bouddha est illimité. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Gobaka ?
On le prie pour purifier l’intention, apaiser les conflits familiaux ou politiques, et pour trouver la force de renoncer à l’orgueil et aux honneurs au profit de la vérité intérieure. Il incarne la sincérité absolue et la puissance pacificatrice qui naît de la transparence du cœur.
Attributs et symboles de Gobaka
-
Visage de Bouddha dans la poitrine : manifestation directe de la nature éveillée, symbole de sincérité et de pureté absolues.
-
Robe entrouverte : geste d’ouverture, d’honnêteté et de vulnérabilité sacrée.
-
Absence d’attachement au pouvoir : enseignement sur la libération des désirs mondains.
-
Médiateur pacifique : celui qui désamorce la guerre sans brandir d’armes.
Gobaka enseigne que la victoire la plus éclatante n’est pas celle remportée par la force ou l’ambition, mais celle obtenue lorsque l’on montre sans peur le cœur véritable — un cœur dans lequel réside la lumière du Bouddha.
10) Panthaka (Pantha l’Ancien) – L’Arhat aux bras longs
(Chinois : 长手罗汉 Chángshǒu Luóhàn ou 半托迦 Bàntuō-jiā — « L’Arhat aux mains infinies »)

Panthaka, frère aîné de Chulapanthaka, naquit le long d’un chemin, ce qui lui valut le surnom de Grand-né-à-côté-de-la-route (Dà Lùbiànshēng), tandis que son frère jumeau reçut celui de Petit-né-à-côté-de-la-route (Xiǎo Lùbiànshēng). Dès l’enfance, Panthaka montra des aptitudes hors du commun : un corps vigoureux, un esprit vif, et surtout des bras anormalement longs qui semblaient s’étirer à volonté. Grâce à ce don, il pouvait cueillir les fruits les plus hauts, atteindre des objets hors de portée et même capturer un oiseau en plein vol.
Malgré cette faculté exceptionnelle, il ne s’enorgueillissait pas et cultivait déjà une curiosité profonde pour les mystères de l’existence. La mort de leur mère, qu’ils aimaient tendrement, les marqua profondément, et les deux frères choisirent alors de quitter la vie laïque pour se faire moines.
Panthaka devint un érudit accompli, formant des centaines d’élèves. Sa destinée bascula le jour où il entendit un moine exposer l’enseignement du Bouddha sur l’interdépendance (pratītyasamutpāda). Cette révélation le poussa à demander l’ordination complète. Il étudia et médita sans relâche, jusqu’à atteindre l’état d’Arhat, puis se consacra à l’enseignement du Dharma à grande échelle.
Selon la tradition, Panthaka réside aujourd’hui dans le Ciel des Trente-Trois (Trāyastriṃśa), au sommet du mont Méru, en compagnie de 900 autres arhats. Ce deuxième paradis du royaume du désir est présidé par Indra (Śakra), souverain des dieux. Panthaka y est représenté la main gauche en vitarka mudrā (geste de l’enseignement) et la main droite tenant un livre, symbole de la transmission du Dharma. On dit qu’il étend ses bras sans limite pour venir en aide à ceux qui aspirent sincèrement à étudier, pratiquer et méditer.
« Facile et confortable,
s’étirant comme l’univers lui-même.
En état d’omniscience,
paisible et heureux de son destin. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Panthaka ?
Il est prié par ceux qui cherchent à approfondir leurs études spirituelles, à élargir leur compréhension et à mettre leurs talents au service des autres. Ses bras extensibles symbolisent la capacité d’atteindre ce qui semble inaccessible, tant sur le plan physique que spirituel. On le sollicite pour étendre la portée de sa compassion et de son savoir, et pour surmonter les limites que l’on croit infranchissables.
Attributs et symboles de Panthaka
-
Bras extensibles : pouvoir surnaturel d’atteindre ce qui est hors de portée, métaphore de l’expansion de l’esprit et de la compassion.
-
Livre du Dharma : connaissance et transmission des enseignements bouddhiques.
-
Vitarka mudrā : geste de l’explication, signe d’un maître qui éclaire les autres.
-
Résidence céleste : symbole de sa réalisation spirituelle et de son lien avec le royaume divin.
Panthaka enseigne que la véritable grandeur n’est pas dans la force physique ou l’érudition seule, mais dans la capacité à mettre ces dons au service des autres, en tendant la main — ou les bras — pour guider, protéger et transmettre la sagesse.
11) Rāhula – L’Arhat perdu dans ses pensées
(Chinois : 罗睺罗 Luóhóuluó ou 沉思罗汉 Chénsī Luóhàn — « L’Arhat méditatif »)

Fils unique du Bouddha Śākyamuni et de la princesse Yaśodharā, Rāhula est l’un des personnages les plus singuliers du bouddhisme ancien. Son nom possède plusieurs interprétations : certains y voient un lien avec Rāhu, divinité céleste responsable des éclipses lunaires, d’autres le traduisent par « entrave », car à l’annonce de sa naissance, Siddhārtha Gautama déclara qu’il constituait pour lui un attachement à surmonter. Les deux sens se rejoignent : une éclipse est un voile posé sur la lumière, tout comme un lien terrestre peut retarder l’éveil.
Naissance et enfance
La tradition raconte que le Bouddha quitta le palais le soir même de la naissance de Rāhula, mais d’autres versions issues des Jātakas affirment que Yaśodharā, ayant décidé de suivre la voie ascétique, porta l’enfant durant six longues années avant de l’enfanter. Cette grossesse inhabituelle provoqua soupçons et accusations, jusqu’à ce que des miracles ou le retour du Bouddha lui-même confirment la paternité.
À l’âge de sept ou huit ans, lors du premier retour de son père à Kapilavastu, Rāhula fut poussé par sa mère à réclamer son héritage royal. Le Bouddha refusa tout bien matériel, lui offrant à la place le Dharma comme trésor suprême. Il demanda alors à son disciple Śāriputra de l’ordonner moine, ce qui causa un émoi considérable au palais. Pour éviter d’arracher ainsi les enfants à leurs familles, le Bouddha institua dès lors la règle de ne plus ordonner de novices sans l’accord parental.
Le novice idéal
Rāhula devint l’exemple même du sikkhākāmā, celui qui désire apprendre. Chaque matin, il jetait une poignée de sable en l’air, déclarant qu’il souhaitait recevoir autant d’enseignements que de grains. Śāriputra lui transmit la doctrine, Moggallāna la discipline monastique. D’une rigueur exemplaire, il dormait parfois à la belle étoile pour ne pas enfreindre la règle qui interdisait aux novices de partager le toit des moines pleinement ordonnés.
Sa détermination fut mise à l’épreuve lorsqu’il dut affronter Māra sous la forme d’un éléphant noir, sans céder à la peur. Le Bouddha lui enseigna personnellement de nombreux suttas, dont le Rahulovāda Sutta, sur l’importance de la véracité, et le Cūla Rahulovāda Sutta, qui le conduisit à l’éveil en compagnie de cent mille devas.
Destin spirituel et vies passées
La tradition enseigne que Rāhula était promis à un destin spirituel hors du commun depuis d’innombrables vies. Sous le bouddha Padumuttara, il formula le vœu de devenir un jour fils de bouddha. Dans ses existences antérieures, il fut roi Naga, prince humain, fils de Gautama sous diverses formes, et parfois même le fils de Śāriputra.
À l’époque du Bouddha Kassapa, il était Pathavindhara, prince de Bénarès, qui fit construire cinq cents logements pour les moines. Sa générosité et son engagement dans la voie du Dharma se répètent ainsi d’ère en ère.
Fin de vie et mémoire
Devenu Arhat alors qu’il était encore jeune, Rāhula mourut avant son père et ses maîtres. On dit qu’il n’avait pas dormi depuis douze ans au moment de son parinirvāṇa, tant sa vigilance méditative était constante. L’empereur Aśoka fit ériger un stūpa en son honneur, lieu de pèlerinage pour les novices.
« Penser et méditer,
tout comprendre.
Au-dessus de ce monde,
libre de toute convention,
la compassion rayonne
jusqu’au neuvième ciel. »
Pourquoi invoquer l’Arhat Rāhula ?
-
Pour cultiver la discipline et la rigueur dans l’étude spirituelle.
-
Pour développer la vérité intérieure et la droiture dans les paroles.
-
Pour se libérer des attachements matériels et recevoir l’héritage du Dharma.
-
Pour fortifier la vigilance et la persévérance face aux épreuves.
Attributs iconographiques
-
Posture méditative : expression d’une réflexion profonde et d’une sagesse précoce.
-
Regard tourné vers l’intérieur : symbole de l’introspection constante.
-
Vêtements monastiques simples : humilité et dépouillement.
-
Parfois représenté tenant un lotus ou un rouleau de sutra, rappelant la pureté et l’étude.
Rāhula incarne la soif d’apprendre et la sincérité du cheminement spirituel, montrant que l’héritage le plus précieux ne se trouve pas dans un royaume terrestre, mais dans l’éveil de l’esprit.
12) Nagaena / Nagasena – L’Arhat nettoyant ses oreilles
(Chinois : 那伽犀那 Nàjiā-xīnà, aussi écrit 那迦犀那 Nàjiā-xīnà ; surnom : 挖耳罗汉 Wā’ěr Luóhàn — « L’Arhat qui nettoie les oreilles »)

Origines et vocation
Nagasena naquit dans une famille royale, héritier d’un trône qu’il ne désirait pas. Dès l’enfance, il percevait la vie de cour comme une prison dorée : les intrigues, les alliances forcées et les décisions lourdes de conséquences, parfois sanglantes, l’effrayaient. Il comprit très tôt que son rôle futur l’exposerait à mener des guerres et à rendre des jugements injustes.
Animé d’une soif sincère de vérité, il se détourna des fastes du palais et, renonçant à tous ses privilèges, alla rejoindre la communauté monastique fondée par le Bouddha.
Sous l’enseignement direct des anciens, Nagasena se plongea dans l’étude du Tripiṭaka, les trois corbeilles du Dharma : le Vinaya (discipline monastique), le Sutta (paroles du Bouddha) et l’Abhidhamma (traités philosophiques). Sa mémoire prodigieuse et son sens de l’analyse le rendirent célèbre dans toute la Sangha. Mais plus encore, on louait chez lui une qualité rare : un détachement absolu vis-à-vis des honneurs, des biens et même de la réputation.
Portrait iconographique
Dans la tradition, Nagasena réside sur le mont Vipulaparśva, entouré de 1 200 arhats. On le représente souvent :
-
Main droite tenant un khakkhara (bâton de moine à anneaux) — symbole du moine itinérant, qui avertit de sa présence et éveille les consciences.
-
Main gauche portant un vase de richesse, qui chasse non seulement la pauvreté matérielle, mais surtout la misère spirituelle.
-
Parfois, dans les thangkas et statues populaires, il est figuré en train de nettoyer son oreille avec une fine baguette ou un petit râteau.
Chez les fidèles, ce geste est interprété littéralement : « il veut entendre clairement les prières de tous ceux qui l’invoquent ».
Chez les sages, il s’agit d’une métaphore subtile : purifier l’oreille, c’est purifier le sens de l’ouïe, afin qu’aucun son — flatterie, critique, rumeur ou illusion — ne trouble la perception de la vérité ultime (tathatā).
Symbolisme spirituel
Dans l’enseignement bouddhique, les portes sensorielles (vue, ouïe, odorat, goût, toucher, pensée) sont à la fois des ouvertures vers la réalité et des vecteurs d’illusions. L’« oreille juste » (sammā-sota), c’est la capacité d’écouter sans se laisser entraîner par l’ego ou l’émotion.
Nagasena rappelle que l’écoute véritable est un acte de méditation :
-
Écouter sans juger.
-
Entendre au-delà des mots.
-
Recevoir le Dharma avec l’esprit clair, comme un lac sans rides.
Légendes et miracles
Des récits populaires racontent que Nagasena, grâce à son écoute pure, pouvait percevoir non seulement les paroles des hommes, mais aussi les murmures des devas, les plaintes des êtres des enfers et même le frémissement des feuilles annonçant un orage.
On dit qu’un jour, entendant dans le vent le gémissement d’une vieille femme mourante à des lieues de là, il envoya un moine la secourir — sauvant ainsi sa vie et l’amenant sur le chemin du Dharma.
« Tranquille et satisfait,
plein d’esprit et d’humour,
curieux du monde et ouvert à la sagesse,
il entend au-delà du bruit des hommes. »
Pourquoi invoquer l’Arhat Nagasena ?
On le prie pour :
-
Purifier l’ouïe : se détacher des ragots, flatteries et discours trompeurs.
-
Cultiver la clarté d’esprit : développer une écoute profonde et juste.
-
Recevoir un enseignement limpide : apprendre à discerner ce qui élève de ce qui distrait.
-
Bénéficier de la prospérité spirituelle, symbolisée par son vase.
Attributs et symboles
-
Khakkhara : vigilance, enseignement itinérant, compassion active.
-
Vase de richesse : abondance intérieure, sagesse partagée.
-
Baguette de nettoyage de l’oreille : purification des sens, préparation à la vision juste.
-
Mont Vipulaparśva et ses 1 200 arhats : autorité spirituelle, unité et force de la Sangha.
13) Ingata / Angida – L’Arhat au sac de toile
(Chinois : 揭陀 Yīnjiē-tuó ou 布袋罗汉 Bùdài Luóhàn — « L’Arhat au sac de toile »)

Origines légendaires
Angida, l’un des tout premiers dix-huit Arhats, était un attrapeur de serpents indien dont la mission consistait à protéger les voyageurs des morsures venimeuses. Plein de compassion, il capturait les reptiles dangereux, leur retirait avec précaution leurs crocs empoisonnés, puis les relâchait dans la nature, leur rendant la liberté sans leur ôter la vie. Ce geste de miséricorde, répété inlassablement, l’éleva jusqu’à l’illumination du Bodhi.
Pour transporter les serpents sans les blesser, il utilisait un sac de toile, qui devint son symbole distinctif.
De l’Inde à la Chine : l’assimilation à Budai
En Chine, à l’époque des Cinq Dynasties (907–960), un moine errant au caractère jovial, nommé Qiècǐ (契此), parcourait la province du Fújiàn avec un grand sac de toile, distribuant sourires, paroles réconfortantes et gestes d’entraide. Les habitants, touchés par sa bonté et son humour, le surnommèrent « le Prêtre au sac de toile ».
Avec le temps, la figure historique d’Angida et celle, populaire, de Budai (布袋) se mêlèrent dans l’art bouddhiste chinois, donnant naissance à l’image familière de l’Arhat corpulent et rieur portant un sac inépuisable.
Symbole et iconographie
Budai est représenté comme un moine ventru et hilare, tenant ou portant un sac qui ne se vide jamais — métaphore de l’abondance du Dharma, de la compassion illimitée et de la générosité inépuisable. Il est souvent entouré d’enfants rieurs, image vivante de la transmission joyeuse et spontanée des enseignements. Dans de nombreux temples, sa figure se confond avec celle de Maitreya, le Bouddha à venir, dont il serait une incarnation terrestre.
« Bouddha de vie infinie,
sac précieux recelant
les secrets du ciel et de la terre.
Joyeux et satisfait,
plein de rires et de bienveillance. »
Pourquoi invoque-t-on l’Arhat Angida ?
On fait appel à lui pour :
-
Transformer le danger en protection, à l’image de ses gestes envers les serpents.
-
Cultiver la générosité joyeuse, capable de réchauffer les cœurs.
-
Recevoir espoir et réconfort, par la bienveillance qui émane de son image.
-
Encourager l’optimisme, même dans les temps les plus troublés.
Attributs et symboles
-
Sac de toile : réceptacle de bonté et d’abondance, capable d’offrir ce qui est nécessaire au moment juste.
-
Silhouette joviale : incarnation de la joie et de la plénitude intérieure, en contraste avec l’austérité monastique.
-
Rires et enfants à ses pieds : union harmonieuse de la sagesse et de l’innocence.
Angida nous enseigne que l’éveil ne se nourrit pas seulement de méditation et d’ascèse, mais aussi de gestes concrets de compassion, de joie sincère et de protection active. Son sac inépuisable et son sourire lumineux sont l’écho éternel d’un cœur ouvert à tous les êtres.
14) Vanavāsin – L’Arhat du bananier
(Chinois : 伐那波斯 Fánà-bōsī ou 芭蕉罗汉 Bājiāo Luóhàn — « L’Arhat au bananier »)

Origines et rencontre avec le Dharma
Autrefois érudit des Védas, Vanavāsin se détourna des honneurs et des affaires du monde pour embrasser la vie d’ascète au cœur de la forêt, en quête de vérité spirituelle. Un jour, le Bouddha vint jusqu’au bosquet où il méditait. La simple vision de l’Éveillé éveilla en lui une foi profonde et immédiate. Recevant l’enseignement, il pratiqua avec dévotion, jusqu’à atteindre l’état d’Arhat.
Le Bouddha le désigna alors comme le plus excellent parmi ceux qui vivent dans la solitude, reconnaissant sa parfaite maîtrise de l’ermitage intérieur et extérieur.
Résidence spirituelle
Vanavāsin réside dans la grotte de Saptaparni, près de Rajagriha, entouré de 1 400 arhats placés sous sa guidance. Il protège le Dharma contre toute force opposée aux Trois Joyaux, dissipe les distractions et aide ceux qui le prient à accomplir leurs aspirations nobles et pures.
Étymologie et symbolique
À sa naissance, une pluie battante se mit à frapper les bananiers près de la maison familiale, produisant un son répété semblable à « vanavassa ». Ce présage donna naissance à son nom. Méditant souvent à l’ombre apaisante d’un bananier, il devint pour les fidèles l’Arhat du bananier, image vivante de refuge et de simplicité.
« Insouciant et tranquille,
il contemple le grand vide.
Céleste dans son essence,
il transcende ce monde mortel. »
Pourquoi l’invoquer ?
On prie l’Arhat Vanavāsin pour :
-
Retrouver la paix intérieure dans la solitude, à l’image de sa méditation forestière.
-
Éloigner les obstacles et distractions qui troublent la voie.
-
Recevoir la guidance et la force tranquille nécessaires à la réalisation des buts spirituels élevés.
Attributs et symboles
-
Grotte de Saptaparni : lieu de méditation, d’écoute et d’enseignement du Dharma.
-
Cercle des 1 400 arhats : symbole d’une fraternité spirituelle soudée et protectrice.
-
Bananier : incarnation de l’abri naturel, de la simplicité et de la méditation paisible.
-
Pouvoirs protecteurs : force subtile qui neutralise ce qui menace la pratique.
Vanavāsin incarne la puissance paisible de l’ermite éveillé : ancré dans la solitude, il veille sur le Dharma et inspire les pratiquants par l’exemple d’une vie simple, profonde et inébranlable.
15) Ajita / Asita – L’Arhat aux longs sourcils
(Chinois : 阿氏多 Ā shì duō ou 长眉罗汉 Cháng méi Luóhàn — « L’Arhat aux longs sourcils »)

Origines et parcours
Dès sa naissance, Ajita présenta tous les signes d’une grande vertu. Ses longs sourcils blancs, semblables à ceux des sages légendaires, étaient perçus comme un présage de sagesse et de longévité. Son père l’entoura très tôt d’un environnement propice à l’étude spirituelle.
Jeune homme, il s’éprit de la fille du roi Prasenajit. Par sa dignité, sa noblesse de cœur et sa droiture, il gagna l’estime du souverain et obtint la main de la princesse, malgré la différence de rang.
Le Bouddha révéla alors qu’Ajita et son épouse, dans une existence antérieure, avaient offert des présents au Bouddha Vipashyin. Celui-ci leur avait prédit qu’ils se marieraient dans une vie future avant de se tourner ensemble vers la voie religieuse. Fidèles à cette prophétie, ils renoncèrent à leurs biens, entrèrent dans la Sangha et Ajita devint l’un des disciples les plus éminents de l’Éveillé.
Résidence spirituelle
Ajita réside aujourd’hui sur le mont Drang-song, la « montagne de l’ermite-sage », accompagné de cent arhats. Sa posture en mudrā de méditation inspire une pratique centrée sur la pureté morale et confère protection, stabilité et détermination à ceux qui suivent la voie.
Iconographie et légende
Dans l’art chinois, Ajita est représenté avec de longs sourcils tombant jusqu’à sa poitrine, symbole de sagesse ancienne et de clairvoyance. Dans la tradition tibétaine, on le retrouve au sein de fresques collectives, entouré de pratiquants rendant hommage au Bouddha, incarnant l’alliance de la méditation profonde et de la bienveillance active.
« Ancien compas de compassion,
moine éveillé depuis toujours.
Voyant l’infini sans paroles,
il éclaire en silence. »
Pourquoi invoquer l’Arhat Ajita ?
On le prie pour :
-
Recevoir force, dévouement et persévérance dans la pratique.
-
Être guidé vers une méditation profonde, protégée par sa sagesse bienveillante.
-
Cultiver dignité spirituelle, courage moral et humilité sincère.
Attributs et symboles
-
Sourcils blancs et longs : marque de sagesse intemporelle et de discernement.
-
Mudrā de méditation : symbole d’attention juste et de maîtrise intérieure.
-
Mont Drang-song : image de la solitude choisie et de la retraite spirituelle.
-
Cercle des cent arhats : incarnation de l’unité et de la continuité de la communauté éveillée.
Ajita incarne la noblesse d’âme née de la foi et du renoncement. De prince à ermite, son parcours rappelle que l’éveil se conquiert par la constance, la discipline et l’humilité, et que la vraie grandeur se mesure à la lumière intérieure qui émane de la sagesse.
16) Cūḍapanthaka (Chota-Panthaka) – L’Arhat gardien
(Chinois : 注荼半托迦 Zhùchá Bàntuō-jiā ou 看门罗汉 Kànmén Luóhàn — « L’Arhat portier »)

Origines et chemin vers l’éveil
Cūḍapanthaka était le frère cadet du célèbre Panthaka, l’Arhat aux longs bras.
Tous deux naquirent au bord d’un chemin, circonstance inhabituelle qui valut à leur nom la signification de « né près de la route », symbole d’un destin en marge des voies ordinaires.
Dès l’enfance, les différences étaient marquées : son frère, doté d’une intelligence vive et d’aptitudes physiques exceptionnelles, excellait dans l’étude et la pratique. Cūḍapanthaka, lui, paraissait terne, lent à apprendre et maladroit, ce qui attira parfois moqueries ou condescendance.
Le Bouddha, pourtant, perçut en lui une force intérieure cachée : la constance. Il lui confia des tâches humbles — servir le thé, accueillir les visiteurs, veiller aux portes du monastère — non comme une punition, mais comme un terrain d’entraînement pour cultiver vigilance, patience et humilité.
Au fil des années, cette discipline silencieuse forgea en lui une concentration aiguisée et une clairvoyance profonde. Par la pratique répétée des enseignements simples et l’attention portée à chaque geste, il atteignit l’état d’Arhat, rejoignant le cercle des éveillés.
Résidence et rôle spirituel
Cūḍapanthaka réside dans l’enceinte sacrée du Dharma, surplombé par les enseignements du Bouddha, entouré de 1 600 arhats mineurs qu’il guide et protège.
Il symbolise la vigilance constante — non celle qui repose sur la peur, mais celle qui émane de la clarté et du sens des responsabilités. Sa présence aux « portes » du Dharma rappelle que l’éveil demande de filtrer ce qui entre dans notre esprit et de rejeter ce qui nuit à la pratique.
Dans les temples, il est parfois associé aux rituels de purification des lieux et de protection des assemblées, incarnant la sentinelle spirituelle qui préserve l’harmonie de la communauté.
Iconographie et symbolisme
-
En Chine, on le représente souvent debout près d’une porte ou d’un mur de monastère, tenant un bâton de moine (khakkhara) dont le tintement chasse les influences négatives.
-
Au Tibet, il peut apparaître assis sous un arbre dépouillé, tenant un éventail ou un bâton, symbole du rafraîchissement spirituel et du souffle clair qui dissipe les brumes de l’ignorance.
-
Au Japon, dans certaines écoles zen, il est assimilé à une figure protectrice des lieux de méditation, marquant l’entrée d’un espace sacré.
Ses traits sont parfois sévères, non par colère mais par attention vigilante, ses yeux semblant sonder l’âme de celui qui approche.
« Puissant, rauque, infatigable,
il veille avec vigilance.
Soutenu d’un bâton bouddhiste,
il dissipe les ombres et anéantit le mal. »
Pourquoi invoquer l’Arhat gardien ?
On s’adresse à Cūḍapanthaka pour :
-
Développer la vigilance intérieure, filtrant pensées et influences nuisibles.
-
Apprendre la valeur du service humble, qui nourrit la force spirituelle à long terme.
-
Protéger la pratique quotidienne contre la distraction et la dispersion.
-
Renforcer la persévérance face aux jugements ou au découragement.
Attributs et symboles
-
Tâches humbles : servir le thé, accueillir les visiteurs — symboles de l’action pure, sans recherche de gloire.
-
Bâton bouddhiste (khakkhara) : outil rituel pour marquer la présence éveillée et éloigner les énergies néfastes.
-
Éventail : apaisement, clarté mentale, fraîcheur de l’esprit.
-
1 600 arhats mineurs : image de la responsabilité étendue et de l’autorité discrète.
-
Portes du monastère : métaphore des portes de l’esprit, à garder avec attention.
Cūḍapanthaka enseigne que l’éveil peut germer dans les gestes les plus simples. Sa vie nous rappelle que la vigilance est une pratique quotidienne, et que la force intérieure naît de la patience et du service désintéressé. Gardien silencieux, il se tient à la lisière entre le monde profane et l’espace sacré, prêt à protéger tous ceux qui entrent sur le chemin du Dharma.
17) Mahākāśyapa – L’Arhat maîtrisant le dragon
(Chinois : 庆友 Qìngyǒu, 降龙罗汉 Jiànglóng Luóhàn — « L’Arhat qui dompte le dragon » ou 摩訶迦葉 Mohejiashe)

Origines et rôle dans la Sangha
Né sous le nom de Pippali dans une famille brahmane de Mahatittha, au Magadha, Mahākāśyapa choisit très tôt la voie ascétique, délaissant les honneurs mondains. Refusant un mariage arrangé, il adopta les treize pratiques austères (dhutangas) et atteignit l’éveil en seulement neuf jours, porté par une discipline sans faille.
Après la disparition du Bouddha, il joua un rôle central en convoquant et présidant le Premier Concile bouddhique, réunissant les arhats afin de préserver l’intégrité des enseignements et la cohésion de la Communauté monastique.
Transmission silencieuse du Dharma
L’un des épisodes les plus célèbres de sa vie survint au Mont des Vautours. Lors du Sermon de la fleur, le Bouddha, sans prononcer un mot, fit tourner entre ses doigts une fleur d’Udumbara. Parmi l’assemblée, seul Mahākāśyapa en saisit le sens profond. Il répondit par un sourire, marquant ainsi la première transmission directe du Dharma d’esprit à esprit (i shin den shin), un geste fondateur dans la tradition du Chan et du Zen.
Le « Dompteur de dragons »
Dans l’iconographie chinoise, Mahākāśyapa est représenté comme le Xianglong Luohan — « Celui qui soumet le dragon ». Le dragon symbolise ici les forces du chaos et de l’illusion ; le dompter, c’est manifester l’autorité spirituelle capable d’apaiser les conflits et de préserver l’ordre du Dharma.
« Dans ses mains, perle spirituelle et bol sacré,
sans bornes est son pouvoir.
Courageux, vigoureux, digne,
il soumet le dragon féroce. »
Pourquoi l’invoquer ?
-
Pour rétablir l’ordre spirituel dans les temps de confusion, comme il le fit après la mort du Bouddha.
-
Pour recevoir la sagesse silencieuse, celle qui transcende les mots et éclaire directement le cœur.
-
Pour stabiliser la pratique, en suivant son exemple de rigueur, d’intégrité et de gouvernance éthique.
Attributs et symboles
-
Robe du Bouddha : symbole unique de la transmission monastique et de l’autorité spirituelle.
-
Dragon maîtrisé : représentation de sa puissance à dominer les forces perturbatrices et protéger le Dharma.
-
Sourire silencieux : signe de la compréhension profonde, au-delà des discours, et de la transmission vivante du Dharma.
Mahākāśyapa incarne la fermeté bienveillante et la sagesse silencieuse. Gardien intransigeant de la discipline, il est aussi le protecteur de la pureté du Dharma, domptant les forces du désordre avec dignité et compassion.
18) Fúhǔ Luóhàn – L’Arhat domptant le tigre
(Chinois : 伏虎罗汉 Fúhǔ Luóhàn ou 宾头卢 Bīntóu-lú — « L’Arhat apprivoisant le tigre »)

Origines et vie monastique
Bīntóu-lú était un moine humble et discret, connu pour sa vie simple et son engagement total envers la méditation et la discipline monastique. Dans son monastère, il passait ses journées à accomplir des tâches modestes — porter l’eau, balayer les allées, entretenir le jardin — avec la même attention qu’il consacrait à ses séances de méditation. Sa sérénité et son absence d’orgueil faisaient de lui un frère respecté, mais il restait à l’écart des honneurs et des intrigues.
La rencontre avec le tigre
Un jour, un événement vint bouleverser la quiétude du monastère. Des rugissements résonnèrent dans la vallée : un tigre immense, aux yeux d’ambre brûlant, s’était aventuré près des bâtiments sacrés. Sa présence glaçait le sang des moines et des fidèles, qui fuyaient à sa vue. Le fauve semblait affamé, ses côtes visibles sous son pelage.
Bīntóu-lú, comme les autres, ressentit d’abord la peur. Mais, au lieu de céder à la panique, il observa le tigre longuement et comprit qu’il n’était pas naturellement cruel : c’était la faim qui enflammait sa férocité. Animé d’une compassion profonde, il prit une partie de sa ration de riz et, s’approchant prudemment, la déposa à bonne distance.
La transformation par la compassion
Les jours suivants, le tigre revint. Chaque fois, Bīntóu-lú partageait sa nourriture. Peu à peu, le fauve s’habitua à sa présence, cessant de gronder ou de montrer les crocs. Au fil des mois, une amitié silencieuse naquit : le tigre ne cherchait plus à effrayer qui que ce soit et, parfois, venait simplement s’allonger près du moine, sans demander de nourriture, comme pour goûter à sa compagnie paisible.
Cette relation devint une parabole vivante pour les habitants de la région : par la générosité et la constance, même la plus farouche des créatures peut s’adoucir.
Signification spirituelle
Dans le bouddhisme chinois, le tigre est à la fois symbole de puissance sauvage et métaphore des passions indomptées de l’esprit : colère, avidité, peur. Dompter le tigre, ce n’est pas l’écraser, mais reconnaître sa nature et la transformer en force alliée. Ainsi, Fúhǔ Luóhàn incarne la maîtrise douce, la puissance tranquille qui apaise les forces destructrices sans violence.
Pourquoi l’invoquer ?
On invoque Fúhǔ Luóhàn pour :
-
Apaiser les peurs profondes et retrouver le calme intérieur face à une situation menaçante.
-
Transformer les conflits en relations harmonieuses, par la patience et la compréhension.
-
Dominer les passions intérieures — colère, violence, ressentiment — en les convertissant en énergie constructive.
-
Trouver la force dans la douceur, la victoire dans la compassion.
Iconographie et symboles
Dans l’art bouddhiste, Fúhǔ Luóhàn est presque toujours représenté avec un tigre à ses côtés, parfois couché calmement, parfois la tête posée sur les genoux du moine. Ce motif est fréquent dans les sculptures sur bois de la dynastie Qing, dans les fresques des temples du Fujian, ou encore dans les peintures murales du mont Emei.
-
Le tigre apprivoisé : image universelle de la force transformée en protecteur.
-
Le geste de partage : souvent représenté en train d’offrir ou de nourrir l’animal.
-
Présence sereine : visage impassible, reflet de l’esprit immuable qui ne cède pas à la peur.
Une célèbre sculpture en bambou du Metropolitan Museum of Art illustre cette scène avec un réalisme touchant : le tigre, loin d’être menaçant, semble écouter attentivement son compagnon humain.
« Anneau précieux aux pouvoirs magiques,
infiniment débrouillard.
Vigoureux et puissant,
il soumet le tigre féroce. »
Fúhǔ Luóhàn nous enseigne que la véritable force spirituelle ne réside pas dans la domination brutale, mais dans la compassion active et persévérante. Par le don, l’écoute et l’absence de peur, il transforme la sauvagerie en loyauté. C’est un maître de la pacification par la présence — celui qui, face au rugissement du tigre, répond par un geste d’offrande.
4) Symboles et enseignements des Dix-huit Arhats
Dans la tradition bouddhiste, les Dix-huit Arhats – ou Luohan (羅漢) – ne sont pas seulement des figures historiques ou légendaires : ils incarnent une véritable carte spirituelle du chemin vers l’Éveil. Chacun d’eux est porteur d’un symbole bouddhiste unique, exprimé à travers son geste (mudrā), son attribut (vajra, perles, bol à aumônes, animaux protecteurs) et son histoire. Leur iconographie, omniprésente dans les temples, peintures murales et sculptures en pierre ou en bois, constitue un langage visuel destiné à rappeler les vertus bouddhistes fondamentales : compassion (karuṇā), sagesse (prajñā), force intérieure, équanimité, générosité et protection contre les forces du mal.
Dans le bouddhisme chinois et tibétain, les Luohan sont considérés comme des protecteurs du Dharma. Leurs symboles agissent comme des talismans spirituels, guidant les pratiquants sur la voie du Noble Sentier Octuple. Le tigre du Fúhǔ Luóhàn représente la maîtrise des instincts et la victoire sur la peur ; le dragon de Jiānlù Luóhàn symbolise la domination de l’esprit sur les forces chaotiques ; le bol à aumônes rappelle l’humilité et le renoncement aux attachements ; le collier de perles (mala) incarne la récitation continue des mantras et la discipline méditative.
Sur le plan spirituel, les Dix-huit Arhats transmettent trois enseignements universels :
-
La persévérance : l’Éveil n’est pas un don, mais un chemin de pratique quotidienne, jalonné d’efforts et de vigilance.
-
L’unité des forces intérieures et extérieures : en domptant tigres, dragons ou démons, l’Arhat montre que la véritable victoire se gagne d’abord sur soi-même.
-
La continuité de la foi : en restant dans le monde jusqu’à l’avènement de Maitreya, les Luohan affirment que l’engagement spirituel se prolonge au-delà de la réalisation personnelle.
Dans les temples chinois, les statues des Dix-huit Luohan sont disposées en longue procession, formant une haie protectrice autour du Bouddha principal. Ce dispositif architectural a une fonction à la fois rituelle et énergétique : canaliser l’attention, protéger l’espace sacré, et inviter le fidèle à traverser symboliquement le cercle de protection avant d’accéder au cœur du sanctuaire.
Ainsi, contempler les Dix-huit Arhats ne relève pas uniquement de l’admiration artistique ; c’est aussi participer à une transmission vivante du Dharma, où chaque regard posé sur ces visages sculptés réveille en nous une qualité spirituelle endormie.
5) Héritage et influence culturelle des Arhats en Chine et en Asie
L’héritage des Dix-huit Arhats dépasse largement le cadre religieux : il s’inscrit dans l’architecture, la sculpture, la peinture et même la littérature de l’Asie bouddhiste. Introduits en Chine à travers les traductions de sūtras et les récits des grands maîtres itinérants, les Luohan sont rapidement devenus un sujet privilégié de l’art bouddhiste chinois, mais aussi coréen, japonais, vietnamien et tibétain.
En Chine, dès la dynastie Tang, les peintures murales et sculptures des Luohan ornent les murs des monastères, souvent placées en procession le long des salles de méditation ou des couloirs menant à la salle principale du Bouddha. Ces représentations agissent comme protecteurs symboliques, invitant le fidèle à pénétrer dans un espace purifié.
Les influences se diversifient selon les régions :
-
En Chine, les œuvres de Guan Xiu (IXᵉ siècle) marquent un tournant, fixant un style reconnaissable – visages allongés, barbes fines, postures méditatives – qui influencera des siècles de peinture bouddhiste.
-
Au Japon, les Rakan (羅漢) sont souvent intégrés dans des ensembles de statues polychromes, comme au temple Tōdai-ji, exprimant la vitalité et la compassion des éveillés.
-
Au Tibet, les Arhats (Neten en tibétain) apparaissent dans les thangkas comme gardiens entourant le Bouddha Shakyamuni, illustrant la continuité de la foi jusqu’à Maitreya.
Sur le plan spirituel, cet héritage transmet un message universel : l’Éveil se déployant à travers des archétypes vivants, chacun incarnant une vertu essentielle. Les statues et peintures deviennent ainsi des supports de méditation, rappelant aux pratiquants les étapes du chemin vers la libération.
Aujourd’hui encore, les Luohan continuent d’inspirer artistes, moines et laïcs. Leur image se retrouve aussi bien dans les temples restaurés que dans l’art contemporain, les séries de peintures à l’encre, les sculptures monumentales ou les expositions muséales internationales. Dans un monde en quête de repères, les Dix-huit Arhats rappellent que la sagesse intemporelle et la compassion active peuvent traverser les siècles et les cultures sans perdre leur force.

Conclusion – Les Dix-huit Arhats, sentinelles intemporelles du Dharma
Dans la poussière des siècles, les dix-huit arhats se dressent comme des silhouettes intemporelles, veillant sur l’enseignement du Bouddha. Ni divinisés comme des bouddhas, ni simples disciples, ils incarnent la force vivante de la communauté éveillée : chacun porte en lui un aspect de la voie, qu’il exprime par la sagesse, la compassion, la rigueur, ou encore la maîtrise des forces sauvages.
Leur diversité reflète la richesse du Dharma : l’ascète errant, le dompteur de dragons, le poète contemplatif, le moine nourrissant un tigre affamé… Autant d’images, de récits et de symboles qui traversent les pays et les époques, du Gandhara à la Chine, du Chan au Zen, sculptés dans le bois, la pierre ou peints sur soie.
Les invoquer ou les méditer, c’est rejoindre une lignée ininterrompue : celle de celles et ceux qui, à travers les âges, ont maintenu la flamme du Dharma allumée contre vents et marées. Ils sont la mémoire vivante de la parole de l’Éveillé, mais aussi son prolongement silencieux dans nos vies.
Peut-être que, dans la clarté d’une méditation ou dans l’ombre d’un rêve, l’un d’eux s’approchera — et qu’à votre tour, vous percevrez ce lien d’esprit à esprit, au-delà des mots, au-delà du temps.